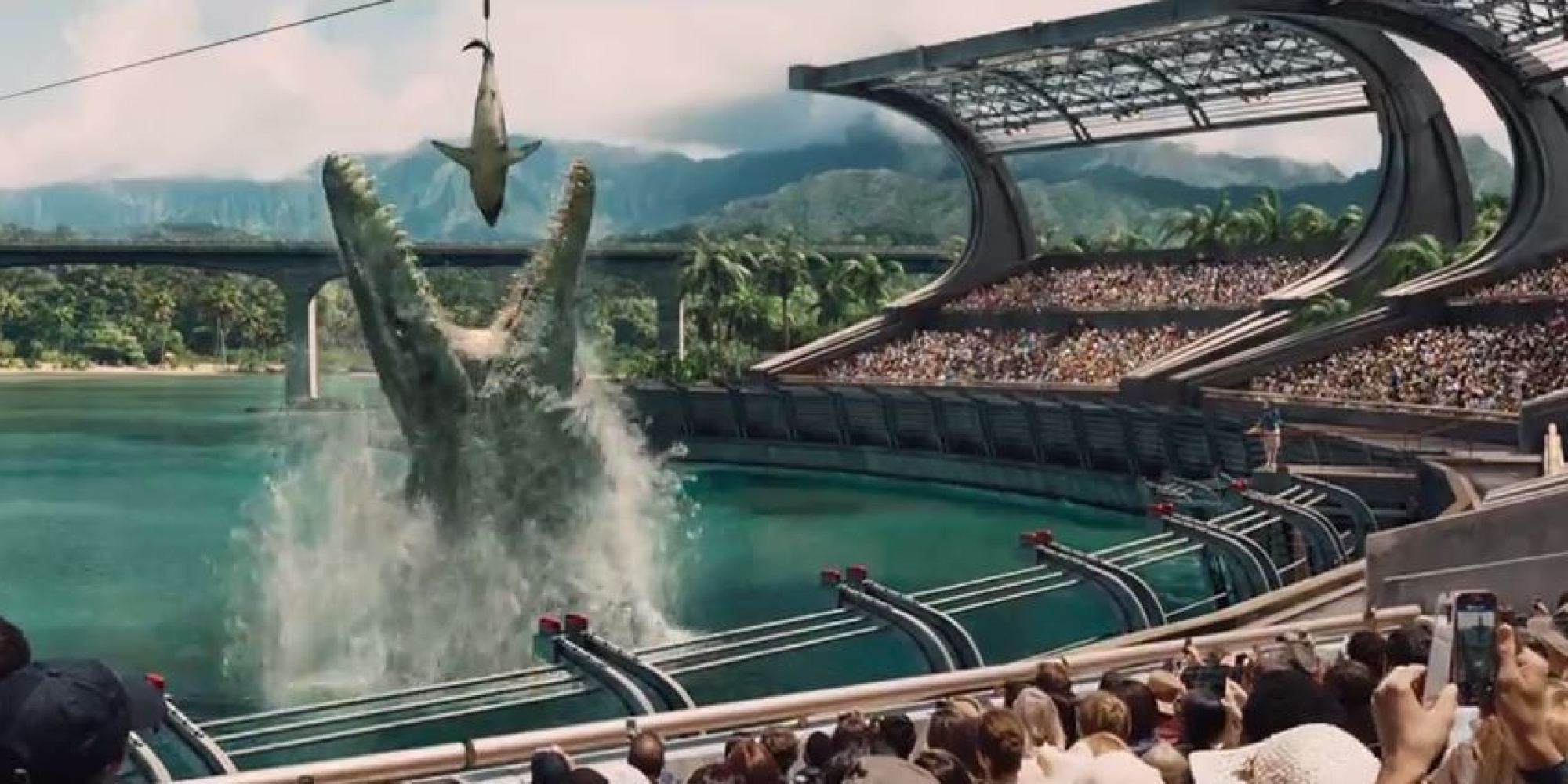C'est vraiment, vraiment des crevards chez Pixar. Franchement, c'est pas permis de pondre un truc pareil, quand on a déjà eu l'idée de Toy Story, de Monstres et Compagnie, de Là-Haut... Et c'est peut-être ici la plus riche, la mieux exploitée de l'histoire du studio. Je n'ai pas dit la plus originale, car ils ne sont pas les premiers à avoir eu l'idée d'imaginer le petit monde des humeurs qui font nos émotions ; des gens aussi différents que Woody Allen et François Pérusse en ont déjà parlé avant. Mais qu'importe, les autres on s'en fout, maintenant on parle de la lampe au déhanché sexy ! Enfin, moi je trouve que son déhanché est sacrément mignon, pas vous ?

En fait, ce n'est pas la peine de lire cet article si vous n'avez pas vu le nouveau Pixar. Juste, allez le voir, faites-moi confiance, et ensuite revenez et on en parle. Parce que je vais en parler, dire deux trois mots, mais en me concentrant sur la substance, plus qu'à l'accoutumée. Parce que beaucoup ont déjà parlé de la technique, des différences entre le monde extérieur et le monde intérieur, de la difficulté d'animer un personnage qui scintille... je n'ai pas envie de parler du fait qu'Amy Poehler était le plus beau choix de casting que j'ai jamais vu à ce jour dans un dessin animé, ni de la sublime musique, je ne veux pas parler de l'évolution du dessin... je veux parler des idées, et des détails, pas vous dire texto que c'est une merveille absolu. Je vais juste le dire maintenant comme ça ce sera fait : je n'ai jamais autant pleuré au cinéma (mais je n'ai vu Là-Haut qu'en DVD, donc, tout de même), et je pense que c'est le film le plus profond, le plus riche, le plus sincère et le plus puissant de l'histoire du studio. Et je dirai bien que je pèse mes mots, mais j'ai déjà fait cette blague dans un article précédent et de toute façon je n'aime pas peser mes mots, je préfère les emporter avec moi et rester coincé dans un ascenseur, on se racontera des histoires. Ok, Vice-Versa, Inside Out, c'est parti ! Quelques petites palabres à peine, sans ordre aucun, et je vous laisse.

L'idée de ce petit monde qui régit nos pensée est déjà bien formidable, mais son utilisation est grandiose. Quand la petite Riley naît, la première émotion à exister c'est la Joie. Déjà, ça se pose là comme vision du monde. On pourrait penser que d'abord un bébé pleure, mais non, Pete Docter a décidé qu'en premier, l'être humain est heureux et émerveillé.
Les émotions se complexifient avec le temps ; autre idée de génie, et le passage dans la tête de la mère nous permet de comprendre par avance la résolution du film. Bannir la tristesse est une idée calamiteuse, il faut savoir s'en servir comme du reste pour avancer dans la vie, et c'est pour cela que Tristesse dirige le mouvement dans la tête de la mère. Ainsi nos émotions se complexifient avec le temps et l'expérience, pour peu que l'on leur laisse la possibilité de le faire, et ainsi le studio d'animation le plus cool de la planète réalise un film sur, ni plus ni moins, l'intelligence émotionnelle. Boum.

A-t-on déjà ri aussi fort dans un cinéma après avoir pleuré aussi bruyamment ? Entre Joie qui empile des petit ami imaginaire brun ténébreux du Canada pour se faire un pont, le passage dans la tête d'un chat ou du garçon qui entre en contact soudain avec Riley, Pixar nous connaît, connaît le monde et sait nous montrer avec ce petit décalage animé que la vie est franchement drôle... et bon, évidemment, tout cela vient après le sacrifice de l'ami imaginaire, que j'ai honnêtement vu venir à trois mille lieux, genre tellement loin que je sais pas combien ça fait une lieu mais je sais que trois mille c'est beaucoup, mais que même comme ça j'en pleurais tellement que je ne voyais plus l'écran. Et avec cette idée de l'ami imaginaire, Pixar me vole ici une pièce de théâtre que j'ai à moitié écrit dans un carnet il y a deux ans, mais franchement comment je pourrais être fâché quand c'est aussi bien mené ? Et puis je pourrais aussi parler du coeur du scénario, la disparition de joie et tristesse, qui font que Riley n'arrive plus à ressentir quoi que ce soit. Et qui donne lieu à cette scène où Dégoût tente d'imiter joie, ce qui crée sarcasme... sans déconner Pixar. Sans déconner. C'est pas permis d'être aussi malin.

Quelques références assez jouissives et même drôles en soi dans ce film : la tête du père qui ressemble à un passage de Star Trek, et surtout la référence gigantissime à Chinatown, j'en serai tombé de mon siège si j'étais dans un cinéma vraiment mal foutu avec des sièges pas bien vissés. Sans parler du passage dans les studios des rêves, là encore grand moment de magie couplé d'humour (le chien coupé en deux sans déconner). Pixar a conscience du cinéma, car Pixar est le cinéma, le grand. Celui qui gravit des montagnes et fait du snowboard sur des bobines en nitrate. Je sais même pas ce que je raconte je vous emmerde ce film déchire sa mère putain.

D'ailleurs je me demande ce qu'il se passe, dans le monde de Vice-Versa Inside Out, quand une personne est au cinéma. Et je me sers de cette phrase pour introduire mon dernier point ; c'est que Pixar a de la suite dans les idées. Et par là je ne veux pas dire qu'il faut faire une suite à ce film, ce serait tout de même assez étrange, mais je veux dire qu'il va rester longtemps, parce que tout l'univers présenté ouvre un milliards (au moins) de possibilités, qui nous permettent de tout repenser sous cette angle. Pixar n'a pas peur de laisser le spectateur sortir avec des questions plein la tête, et c'est grâce à cela que nous avons des théories totalement fantasques sur l'univers dépeint par le studio, et c'est tant mieux ! Le train de pensée, les pensées abstraites (séquence d'animation magistrale tiens ça d'ailleurs), le subconscient, la putain de musique de dentifrice qui revient tout le temps... c'est là que je pense que Pete Docter a Vréussi (quoi ? Mais on écrit pas réussi avec un V ?) avec un grand V (aaaah ben ok) puisque ce film, je l'annonce je n'en ai pas peur, on va en parler très, très longtemps.

Je vais vous donner un seul exemple ; dans un monde comme celui de Vice-Versa, qui prend les décisions ? Est-ce que Riley est entièrement déterminée par les actions des êtres pensants qui vivent en son sein, ou bien est-ce elle-même qui par son évolution, guide ses émotions là où elle tente d'aller. Le monde selon Pixar, déterministe ou pas déterministe ? Vous pensez bien que je ne vais pas vous apporter la réponse... la beauté réside toujours dans la question.